A DIM 31 - Tous frères !
« Ne donnez à personne sur la terre le nom
de père… »
C’est un peu fort quand même ! Bon, ne pas donner à
quelqu’un des titres comme « Maître » ou « Monseigneur »
« éminence », ou encore
« Saint-Père », on peut encore le comprendre. Les titres ronflants,
si appréciés dans certains milieux, n’ont pas vraiment leur place dans une
Eglise qui se veut « synodale », communautaire et égalitaire.
Mais « Père », quand même ! Des cohortes de psychiatres ne nous
rappellent-elles pas la nécessité pour chaque être humain d’avoir, dans sa vie,
donné à quelqu’un ce beau nom de « père » ou de « mère » pour
pouvoir grandir ?
Outre le fait que dans l’antiquité, le « pater
familias » représentait un réel pouvoir, une autorité indiscutable dont il
n’était pas bon de se distancier, il reste qu’aujourd’hui, le rôle du père,
même s’il est contesté, ou critiqué à cause de son absence précisément, ce rôle
semble toujours indispensable pour séparer l’enfant d’une relation fusionnelle
avec la mère et le « mettre au monde » d’une manière plus large.
Il est vrai cependant que la notion même de la famille a
connu une mutation extraordinaire en quelques décennies, rompant avec un modèle
communément admis un peu partout dans le monde (même s’il y avait des exceptions).
Les règles de parenté et de filiation qu’on continue à transmettre malgré tout prennent de nouveaux contours, et l’adage qui dit « qu’on ne choisit pas sa famille » semble ne plus correspondre à la réalité. C’est ce qui ressort d’un livre récemment écrit par la philosophe Sophie Galabru (comme l’acteur !) intitulé « Faire famille ». Le titre même est évocateur : On n’est plus une famille, comme quelque chose qui s’imposait de soi, mais on choisit de faire famille.
En effet, aujourd’hui, avec la disparition de la pression
sociale sur les liens familiaux, la multiplication des divorces et la
diminution des mariages, le nombre de familles recomposées est devenu si
important qu’elles sont devenues pratiquement la norme. Désormais, on
choisit ses partenaires -et pas seulement les conjoints-, ceux avec qui on
choisit de vivre, et on les garde tant qu’ils conviennent. Les liens
familiaux en sont profondément modifiés : Les enfants ont souvent, en
plus des parents qu’ils voient ou ne voient plus, des beaux-parents (qu’on
appelle parfois papa ou maman), des beaux-grand-parents, des demi-frères et
demi-sœurs, avec des relations qui s’établissent en intensité variable.
Dans la plupart des familles actuelles, il y a des
personnes avec lesquelles on entretient un certain nombre de relations, et
d’autres avec lesquelles on a pris distance ou qu’on a choisi de ne plus voir.
C’était inimaginable auparavant : On était une famille, cela impliquait que
les liens ne pouvaient être rompus ou distendus – sauf si un conflit grave
avait lieu, mais même dans ce cas, on ne reniait pas la parenté. D’autre part,
la famille étendue s’est de plus en plus nucléarisée, le nombre de parents
élevant seuls leur enfant unique lui aussi s’est considérablement élargi.
Ce changement de norme est si fondamental qu’il affecte
toute la société. Et pas seulement en termes de demandes de logement pour père
ou mère solo. Une nouvelle mentalité est apparue qui, d’après la philosophe
Sophie Galabru, renoue avec la pratique ancestrale primitive de l’homo sapiens,
alors qu’il n’existait pas encore de pression d’une société qui impose des
règles à la vie familiale comme cela fut le cas à partir du Moyen-âge. Selon
les anthropologues et spécialistes de la préhistoire, nos ancêtres sapiens
échangeaient volontiers leurs partenaires, et mêmes les enfants étaient élevés
indifféremment par des membres du clan.
Cette réflexion sur la mutation du lien et de la notion
même de famille est très intéressante. Se pose bien sûr la question :
est-ce un bien ou un mal ? Devons-nous en avoir peur ? Qu’est-ce
qu’un père ou une mère aujourd’hui ?
Ce n’est pas simple d’y répondre. Les témoignages abondent de personnes qui lorsqu’elles étaient enfant, ont été élevées par quelqu’un qui n’était ni son père ni sa mère biologique. Elles se sont construites avec les matériaux qu’elles avaient sous la main et les valeurs reçues de divers proches, parents ou non.
Cela a certainement conduit à une plus grande ouverture,
dans le sens où la transmission des valeurs et croyances du clan familial qui
étaient jadis plus ou moins immuables, font désormais l’objet d’un choix
beaucoup plus large, les sources étant d’office plus variées. L’effondrement
des croyances ou valeurs chrétiennes est probablement lié en partie à ce
phénomène. On ne reçoit plus ses valeurs ou sa foi de ses parents. Et d’autre
part, ceux-ci ne cherchent plus à les transmettre, pour ne pas se voir
reprocher dans l’espace éclaté de la « nouvelle famille » d’imposer
un modèle plus qu’un autre. Chacun doit choisir lui-même sa route, chacun
son chemin. La liberté conquise sur l’ancien modèle familial a ce prix à
payer, celui d’une plus grande solitude morale. Cette liberté peut être vue
comme une chance, mais elle représente aussi possiblement un défi pour la
construction de la vie relationnelle en tant qu’humain, car plus instable et
fragile.
Bien. Alors, que penser de la recommandation de Jésus de ne donner à personne le nom de « père » ? (ou maître ou docteur…)
Irait-il dans le sens de ceux qui prônent l’éclatement
total des familles tant ils en ont ressenti le caractère quelquefois coercitif
ou blessant, du genre : « Familles, je vous hais ! »
Est-ce que cette parole de Jésus serait liées au fait que
sa propre filiation est très mystérieuse au point qu’on n’a vue en Joseph qu’un
« père nourricier » ? En fait, chaque fois que Jésus a à la
bouche le mot « père », il parle de la relation qui l’unit à Dieu.
Cette relation est essentielle pour lui, et fonde toutes les autres qui lui
sont subordonnées.
Pour reprendre le commentaire de l’abbé Lobet dans le journal Dimanche de cette semaine, Jésus ne dénigre ni les pères, ni les mères, ni les maîtres ou les docteurs, les enseignants. Il sait bien que nous en avons besoin. Mais comme il l’a déjà proclamé dans un autre passage évangélique : « Qui sont ma mère et mes frères ? Ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. » (Luc 8,21). Ainsi donc pour Jésus, la vraie famille est la famille spirituelle, celle qu’on a choisie parce qu’elle met Dieu au centre et cherche à vivre selon ses préceptes.
Les pères et les mères reçus de la vie, quels qu’ils soient, les maîtres et les enseignants sont aussi nécessaires. Mais, dit l’abbé Lobbet, n’oublions pas que ces statuts, pour indispensables qu’ils soient, sont aussi réversibles. Ils ne sont pas éternels, même ceux qui semblent le mieux établis comme la paternité ou la maternité. Et il ajoute, ce qui rejoint tout à fait l’expérience que je suis en train de vivre actuellement : Si on a la chance de veiller un parent âgé, on comprend vite que l’on devient aussi le père de son père, la mère de sa mère. Dans l’Eglise pareillement, nous avons besoin de pères (le mot « abbé » veut dire père) et de mères (abbesses). Et même d’un Saint-Père (le pape).
Mais n’oublions pas que ces rôles sont également provisoires, et que, fondamentalement, devant Dieu, nous sommes avant tout des frères et des sœurs, enfants d’un unique Père, celui qui est aux cieux. Jésus a inventé la synodalité avant que ce terme n’existe ! Jésus donc nous appelle à cette fraternité foncière, seul remède au mal qu’il dénonce par ailleurs chez les responsables religieux de son temps (et de tous les temps) qui « lient de pesants fardeaux et les mettent sur les épaules des gens alors qu’eux-mêmes se refusent à les remuer du doigt ». C’est le cléricalisme, ce mal qui hélas existe encore de nos jours dans bien des institutions religieuses.
Le remède à ce mal, et à bien d’autres maux qui s’appellent la domination, la recherche de pouvoir, la violence, les abus en tous genres et la guerre, le remède à ce mal, Jésus nous l’indique et nous le propose aujourd’hui, c’est tout simplement mais véritablement : LA FRATERNITE !
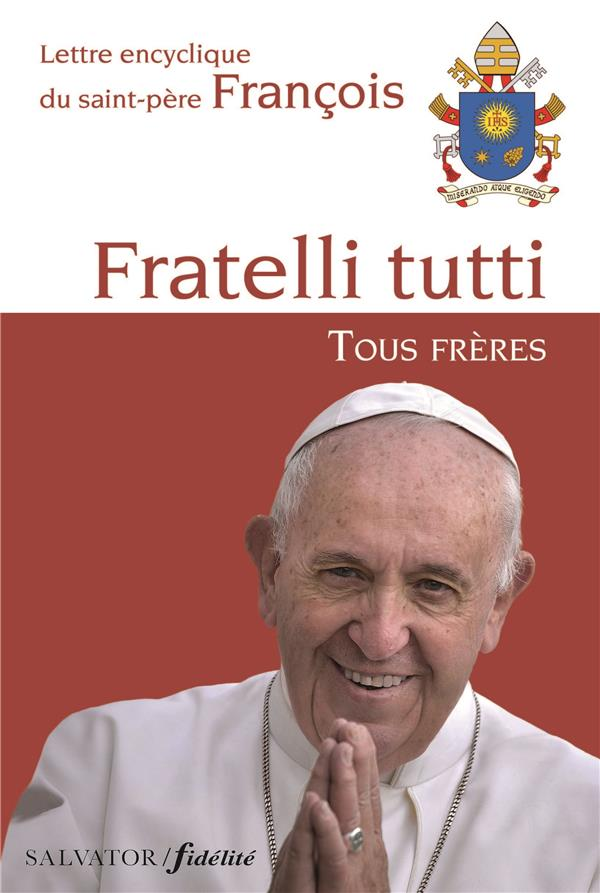
Osons la vivre !







Commentaires
Enregistrer un commentaire